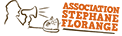Chaque année, des animaux sauvages recueillis par des particuliers, deviennent incapables de survivre dans leur milieu naturel.
Trop habitués à l’homme, ils perdent leurs instincts de chasse, leur méfiance envers les prédateurs et leurs capacités d’adaptation à la vie sauvage.
Plutôt que de leur offrir une seconde chance en captivité, la loi impose bien souvent une solution radicale : l’euthanasie.
Entre cadre légal strict, impératifs écologiques et dilemmes éthiques, cette réalité soulève une interrogation : comment concilier protection de la faune et compassion pour ces êtres devenus dépendants des humains ?
Peut-on recueillir un animal sauvage ?
La réponse est oui pour certaines espèces et sous conditions strictes, et non pour les animaux protégés, dangereux ou issus de la faune locale.
En France, la détention d’animaux sauvages est encadrée par plusieurs textes dont le Code de l’environnement qui interdit la capture, la détention et l’apprivoisement d’animaux sauvages sans autorisation ;
L’arrêté du 8 octobre 2018 définit les espèces qui peuvent être détenues sans autorisation et celles nécessitant un certificat de capacité.
La législation inclut les animaux blessés que l’on ne doit pas garder chez soi.
Face à une situation de détresse (oiseau tombé du nid, hérisson blessé, faon isolé…), il faut contacter un centre de soins pour la faune sauvage (LPO, sanctuaires, vétérinaires spécialisés) et ne pas trop manipuler l’animal pour éviter qu’il s’habitue à l’homme (phénomène d’imprégnation).
Quelles espèces sauvages peut-on légalement posséder ?
Plusieurs espèces non domestiques peuvent être détenues sans formalités particulières, comme certains poissons d’aquarium, des reptiles (geckos, tortues d’eau non protégées), quelques oiseaux et rongeurs exotiques (perruches, cochons d’Inde).
Parmi les cas particuliers, citons :
Les mammifères sauvages (renards, écureuils, cerfs, loups, primates…) dont la détention est interdite sauf autorisation ;
·Les rapaces (chouettes, hiboux) dont la possession est strictement réglementée ;
Les serpents venimeux, grands reptiles et fauves qui nécessitent un Certificat de Capacité (CDC) et des installations adaptées.
Pourquoi les animaux domestiqués ne peuvent pas retourner à l’état sauvage ?
En France, les autorités ont recours à l’euthanasie des animaux sauvages domestiqués ou imprégnés parce qu’ils ne peuvent ni être relâchés dans la nature ni légalement détenus par des particuliers sans autorisation spécifique.
Cette politique repose sur plusieurs motifs dont :
L’impossibilité d’un retour à la nature
Un animal sauvage imprégné par l’homme ne sait plus chasser, fuir les prédateurs ou interagir correctement avec ses congénères.
Son comportement modifié le rend inapte à la survie dans son milieu naturel.
Par exemple, un renard ou un sanglier élevé par l’homme peut se montrer trop confiant et s’approcher des humains, augmentant les risques de conflits ou d’accidents ;
La préservation des écosystèmes
Les autorités cherchent à éviter la perturbation des chaînes alimentaires et des équilibres écologiques.
Relâcher un animal inadapté pourrait introduire une pression supplémentaire sur d’autres espèces.
Ainsi, un oiseau de proie nourri par l’homme pourrait perdre sa capacité de chasser, réduisant son rôle dans la régulation des populations de petits mammifères ;
Le risque de transmission de maladies
Les animaux sauvages sont parfois porteurs de maladies transmissibles à l’homme (zoonoses) ou à d’autres animaux (épizooties) comme la rage chez les renards ou les chauves-souris, la tuberculose chez les blaireaux ou la grippe aviaire chez les oiseaux.
Un animal sauvage captif peut aussi accumuler des parasites internes ou externes susceptibles de contaminer d’autres animaux lors d’une éventuelle réintroduction.
Pourquoi les animaux sauvages domestiqués sont-ils euthanasiés ?
Pour les raisons énumérées ci-dessus, la loi française interdit aux particuliers de détenir des animaux sauvages sans autorisation.
Si un particulier trouve un animal et le garde sans déclarer la situation aux autorités, il se trouve en infraction.
Lorsque ces cas sont signalés, l’animal est saisi par les services de l’État et sont souvent euthanasié.
Pourquoi ?
Car il existe très peu de centres de sauvegarde spécialisés, et ceux qui existent sont souvent saturés.
D’autre part, certains sanctuaires refusent les animaux domestiqués de crainte qu’ils nuisent à ceux qui doivent être réhabilités pour un retour à la nature.
Les autorités invoquent également des questions de sécurité : un spécimen sauvage (sanglier, renard, rapace…) imprégné peut devenir dangereux en grandissant, même s’il a été élevé par des humains.
Par conséquent, si l’animal est dans l’impossibilité d’être relâché ou accueilli dans une structure, l’administration recourt à l’euthanasie.
Quelles sont les alternatives à l’euthanasie ?
L’euthanasie des animaux sauvages domestiqués résulte d’un conflit entre les impératifs légaux, écologiques, sanitaires et sécuritaires.
Bien que souvent présentée comme une solution inévitable, elle est de plus en plus contestée par les associations de protection animale et certains experts en faune sauvage.
Plusieurs alternatives sont avancées pour éviter cette issue fatale :
·La création de sanctuaires spécialisés offrirait un espace sécurisé où ces animaux pourraient vivre sans représenter de danger pour la biodiversité ou le public.
Ces structures existent déjà pour certaines espèces (loups, primates, rapaces), mais leur nombre est insuffisant et leurs capacités d’accueil limitées ;
Plutôt qu’une politique systématique, une évaluation au cas par cas permettrait de fournir des solutions adaptées.
Certains animaux, bien que domestiqués, ne présentent ni danger ni risque écologique majeur.
Dans un tel contexte, un placement en parc zoologique, en centre de soins ou chez un particulier qualifié sera envisageable sous certaines conditions (surveillance vétérinaire, installations adaptées, interdiction de reproduction) ;
Dans des situations exceptionnelles, certaines personnes ayant recueilli un animal sauvage et assurant son bien-être pourraient se voir accorder une autorisation spéciale de détention.
Cet encadrement plus souple des particuliers éviterait l’euthanasie dans des cas où l’animal est bien intégré à un foyer et ne constitue pas de menace ;
Plutôt que de gérer les conséquences de l’imprégnation des animaux sauvages, il serait intéressant d’agir en amont en sensibilisant le public aux risques et aux responsabilités liés à la détention d’animaux sauvages.
Des campagnes d’information pourraient limiter les situations où des particuliers recueillent des animaux sans en mesurer les implications.
Pas d’euthanasie pour Rillette : l’exception à la règle ?
En janvier 2025, l’histoire de Rillette, une laie recueillie alors qu’elle était marcassin par une éleveuse de chevaux dans l’Aube, a suscité une vive émotion.
Devenue membre à part entière de la famille, l’animal risquait l’euthanasie s’il n’était pas transféré dans un centre spécialisé, conformément aux dispositions légales invoquant des raisons sanitaires et de sécurité.
Malgré des tentatives infructueuses de réintroduction dans la nature, au cours desquelles Rillette retournait systématiquement vers son foyer d’accueil, les autorités ont maintenu leur position.
Après rééxamen du dossier, le préfet a finalement régularisé la situation du sanglier, sous réserve du respect de conditions strictes incluant un suivi vétérinaire régulier et rigoureux, la mise en place d’un enclos sécurisé, propre et bien délimité, empêchant tout contact avec d’autres suidés.
De plus, Rillette ne peut pas sortir de cet enclos, qui doit répondre à ses besoins spécifiques en eau et en nourriture.
Cette décision résulte d’une mobilisation considérable marquée notamment par une pétition recueillant plus de 170 000 signatures et le soutien de personnalités comme Brigitte Bardot.
Cette affaire souligne les défis liés à la détention d’animaux sauvages domestiqués en France et pourrait ouvrir la voie à une réflexion sur l’adaptation des réglementations en la matière.