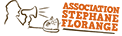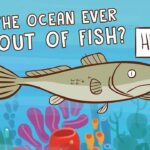Sous sa coquille marbrée, se cache un redoutable tueur des lagons.
Présent en Polynésie française, le cône géographe, un escargot marin au venin foudroyant, est capable de paralyser sa proie, et parfois l’homme, en un seul tir.
Ce coquillage à l’allure inoffensive est en réalité le mollusque le plus dangereux du monde.
Le cône géographe présent dans les lagons de Tahiti et des archipels du Pacifique, détient un triste record : la quasi -totalité des décès humains connus par envenimation de cône lui sont attribués.
Sa particularité ?
Un harpon venimeux et un venin composé de conotoxines capables de paralyser en quelques minutes.
Cône géographe : le coquillage le plus dangereux du monde
Le cône géographe est long d’une quinzaine de centimètres.
Il possède une coquille calcaire, lisse et effilée, souvent blanche ou crème, ornée de motifs brun-rouge.
Cette beauté discrète dissimule un redoutable chasseur nocturne.
Tapie dans le sable des récifs pendant la journée, l’espèce sort la nuit pour traquer ses proies, des petits poissons.
Il les chasse alors grâce à son sens olfactif très développé et son harpon venimeux qu’il propulse par une puissante contraction musculaire.
Il injecte alors un cocktail neurotoxique redoutable.
C’est ce mécanisme qui le rend dangereux pour l’humain lorsqu’il est manipulé.
Selon les travaux de H. Terlau et B.M. Oliveira, « Venins de cônes : une riche source de nouveaux peptides ciblant les canaux ioniques« , publiés en 2004, le taux de mortalité humaine lié à ses piqûres atteindrait 65 à 70 %.
Ce qui fait du cône géographe non seulement un danger pour les poissons, mais aussi pour les plongeurs qui auraient la mauvaise idée de le ramasser.
Au registre des accidents, la littérature scientifique recense 141 envenimations humaines entre 1670 et 2017, dont 36 mortelles.
Où trouve-t-on le cône géographe ?
Le cône géographe est une espèce tropicale présente dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, des côtes du nord de l’Australie jusqu’à la Polynésie Française , en passant par Madagascar, les Maldives, l’Indonésie, les Philippines et la Nouvelle-Calédonie.
Selon la base scientifique DORIS (FFESSM), il est particulièrement abondant dans les lagons et récifs coralliens peu profonds, entre la surface et 20 mètres de profondeur.
L’animal affectionne les zones sablonneuses et les fonds coralliens fragmentés, où il peut se dissimuler partiellement pour surprendre ses proies.
Le jour, il reste enfoui, quasi immobile ; la nuit, il s’anime, explorant le fond marin à la recherche de poissons endormis.
Comme le rapporte le musée de zoologie de l’université du Michigan, certains chercheurs suggèrent que les mâles pourraient même défendre un territoire de chasse, une rareté chez les mollusques.
En tant que prédateur piscivore, le cône géographe joue un rôle essentiel dans l’équilibre des récifs coralliens en régulant les populations de petits poissons.
Cône géographe : comment agit son venin sur l’homme ?
Le mécanisme de défense du cône géographe est aussi ingénieux que redoutable.
L’animal possède un appareil venimeux complexe, composé notamment d’un sac radulaire et d’une trompe extensible.
À l’extrémité, une dent creuse en forme de harpon sert à injecter le venin.
En une fraction de seconde, cette fléchette traverse même un tissu léger ou une combinaison de plongée.
Son venin, composé de centaines de peptides différents, varie selon l’usage qu’en fait l’animal : pour chasser ou pour se défendre.
Les chercheurs distinguent ainsi des conotoxines dites « offensives », destinées à immobiliser la proie, et d’autres « défensives », produites pour repousser un prédateur.
Chez Conus geographus, ce cocktail neurotoxique d’une puissance extrême agit directement sur le système nerveux : il bloque les canaux ioniques et interrompt la transmission des signaux musculaires, entraînant une paralysie rapide.
Les symptômes apparaissent en quelques minutes : douleur vive, engourdissement, vertiges, troubles de l’élocution, puis parfois paralysie respiratoire pouvant entraîner la mort en moins d’une demi-heure.
« 70 % des victimes meurent en moins de deux heures », rappelait la biochimiste Lourdes Cruz .
Que faire en cas de piqûre de cône géographe ?
À ce jour, aucun antidote n’existe contre le venin du cône géographe.
La survie dépend d’une prise en charge précoce, d’après le musée de zoologie de l’université du Michigan.
En cas de piqûre, les secours doivent être alertés immédiatement et la victime transportée en service de réanimation.
Il est important d’immobiliser la zone atteinte, de nettoyer la plaie et tenter d’extraire la dent venimeuse si elle est visible.
Il faut éviter tout garrot et maintenir la victime consciente, en assurant une assistance respiratoire en cas de paralysie.
La meilleure protection reste la prudence : ne jamais ramasser un coquillage vivant lors d’une plongée ou sur un récif corallien.
À ce jour, ce venin mortel fait toujours l’objet de recherches médicales, et certaines conotoxines sont étudiées pour développer des analgésiques puissants capables de remplacer la morphine.
Quel est le coquillage le plus rare au monde ?
Si le cône géographe détient le record du plus dangereux, d’autres coquillages se distinguent par leur extrême rareté.
Selon le Guinness World Records, le plus rare reste la porcelaine à dents blanches , connue par seulement deux spécimens, dont l’un aurait été découvert en 1960 dans la mer de Sulu, aux Philippines, à l’intérieur de l’estomac d’un poisson pêché dans la région.
Le Cauris incomparable , découvert dans le golfe d’Aden et décrit en 1993.
Cette espèce appartenant à la famille Eocypraeidae, que l’on croyait éteinte depuis des millions d’années, est qualifiée de « fossile vivant ».
De la même façon, Conus gloriamaris, surnommé« Gloire du cône marin », fut pendant plus de deux siècles la coquille la plus recherchée au monde : quelques dizaines de spécimens connus, une valeur qui dépassait parfois celle d’œuvres d’art.